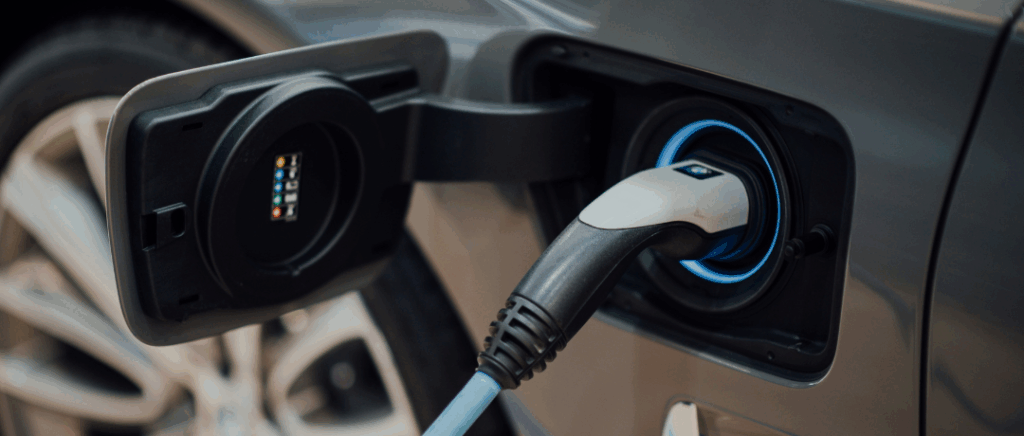ZFE : de quoi parle-t-on exactement ?
Une réponse aux enjeux climatiques et sanitaires
Les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) sont un dispositif clé dans la lutte contre la pollution atmosphérique, un problème majeur en France et en Europe. Ce concept repose sur une idée simple mais ambitieuse : limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines zones urbaines pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé publique. Instaurées par la loi Climat et Résilience de 2021, ces zones concernent les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les seuils réglementaires de pollution sont régulièrement dépassés.
En effet, selon Santé Publique France, la pollution de l’air est responsable de 40 000 décès prématurés chaque année en France. Les particules fines (PM10, PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO₂), principalement émis par le trafic routier, sont à l’origine de maladies respiratoires graves, d’accidents cardiovasculaires et même de cancers.
En Île-de-France, par exemple, on estime que réduire ces polluants pourrait éviter près de 5 000 décès prématurés chaque année. Les ZFE visent donc à réduire ces émissions en interdisant progressivement les véhicules les plus anciens et polluants grâce au système des vignettes Crit’Air.
Au-delà des impacts sanitaires, les ZFE jouent un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique. En réduisant les émissions de CO₂ liées au trafic routier, elles contribuent à atteindre les objectifs européens fixés par la directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air. Par exemple, en Île-de-France, l’instauration d’une ZFE a permis une baisse de 5 % des émissions de CO₂ liées au transport routier dès sa mise en place.
Avec plus de 320 zones similaires déployées dans des villes européennes comme Londres ou Berlin, les ZFE ne sont pas une spécificité française. Leur efficacité a été démontrée : diminution des concentrations de polluants dans l’air et amélioration notable de la santé des habitants. En France, 42 agglomérations sont concernés par la mise en place d’une ZFE depuis le 1er janvier 2025.
Lisez aussi notre article :
Fonctionnement des ZFE : critères, véhicules concernés, villes ciblées
Comme énoncé brièvement précédemment, le fonctionnement des ZFE repose sur un mécanisme bien défini : la classification des véhicules particuliers à travers la vignette Crit’Air. Celle-ci permet de classer les voitures selon leur niveau d’émissions polluantes, en se basant sur leur motorisation (essence ou diesel) et leur date de première immatriculation.
Les voitures sont ainsi réparties en 6 catégories, de Crit’Air 0 (véhicules 100 % électriques ou à hydrogène, donc non polluants) à Crit’Air 5 (les diesel les plus anciens). Ce système facilite l’identification des véhicules les plus polluants et permet aux autorités locales de fixer des restrictions de circulation ciblées dans les zones concernées.
Lisez aussi notre article :
Avant le 1er janvier 2025, la plupart des ZFE ciblaient prioritairement les véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés, considérés comme les plus polluants. Depuis cette date, les règles se durcissent dans de nombreuses agglomérations. Désormais, les véhicules classés Crit’Air 3 sont également dans le viseur :
- Diesel immatriculés entre 2006 et 2010
- Essence immatriculés entre 1997 et 2005
💡Le saviez-vous ? Les véhicules ayant la vignette Crit’air 3 représentent environ 14,3 millions d’unités, soit 41 % du parc automobile national.
| Vignette Crit’Air | Type de véhicule | Date d’immatriculation |
|---|---|---|
| Crit’Air 0 (vert) | Véhicules 100 % électriques ou à hydrogène | Tous |
| Crit’Air 1 (violet) | Hybrides rechargeables et essence | À partir de 2011 |
| Crit’Air 2 (jaune) | Essence (2006–2010), Diesel (à partir de 2011) | 2006 à 2010 (essence), 2011+ (diesel) |
| Crit’Air 3 (orange) | Essence (1997–2005), Diesel (2006–2010) | 1997 à 2005 (essence), 2006 à 2010 (diesel) |
| Crit’Air 4 (bordeaux) | Diesel (2001–2005) | 2001 à 2005 |
| Crit’Air 5 (gris) | Diesel (1997–2000) | 1997 à 2000 |
| Non classé | Essence ou diesel immatriculés avant 1997 | Avant 1997 |
💡Important à savoir : Pour ne pas pénaliser les usagers ayant des cas spécifiques, certaines dérogations ont été prévues, notamment :
- Les véhicules d’urgence (ambulances, pompiers, etc.)
- Les personnes en situation de handicap titulaires d’une carte mobilité inclusion
- La dérogation « petit rouleur » : 52 jours de circulation autorisés par an pour les véhicules normalement interdits
- Les professionnels confrontés à des délais de livraison ou à des usages ponctuels indispensables
Pour vous fournir un aperçu plus approfondi des villes concernées en 2025, voici ci-dessous un tableau récapitulatif :
| ZFE en vigueur | ZFE À VENIR |
|---|---|
|
Rouen
|
Dunkerque
|
|
Paris et métropole du Grand Paris
|
Lille
|
|
Reims
|
Béthune
|
|
Strasbourg
|
Douai-Lens
|
|
Lyon
|
Valenciennes
|
|
Grenoble
|
Amiens
|
|
Saint Etienne
|
Metz
|
|
Nice
|
Nancy
|
|
Aix-Marseille
|
Mulhouse
|
|
Clermont-Ferrand
|
Dijon
|
|
Montpellier
|
Annemasse
|
|
Toulouse
|
Annecy
|
|
|
Chambéry
|
|
|
Toulon
|
|
|
Avignon
|
|
|
Nîmes
|
|
|
Perpignan
|
|
|
Pau
|
|
|
Bayonne
|
|
|
Bordeaux
|
|
|
Limoges
|
|
|
Orléans
|
|
|
Tours
|
|
|
Angers
|
|
|
Nantes
|
|
|
Le Mans
|
|
|
Brest
|
|
|
Rennes
|
|
|
Caen
|
|
|
Le Havre
|
Les conséquences financières de la suppression des ZFE
Perte des subventions européennes et remboursements possibles
La suppression des ZFE, votée en commission parlementaire le 26 mars 2025, pourrait avoir des répercussions financières colossales pour la France. Selon une note de la Direction générale du Trésor, cette décision met en péril plus de 3 milliards d’euros d’aides européennes prévues dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (PNRR), plan faisant suite à la crise sanitaire et financé en partie par l’UE.
Ce revirement politique fait suite au vote de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification administrative, qui a validé plusieurs amendements visant à supprimer les ZFE (par 26 voix pour vs. 11 contre et 9 abstentions). Ces propositions, portées par des députés Les Républicains et du Rassemblement national, ont été adoptées avec le soutien de membres d’autres groupes parlementaires, et ce contre l’avis du gouvernement.
À ce titre, les ZFE sont critiquées par certains élus qui estiment qu’elles pénalisent injustement les ménages modestes, souvent contraints de conserver des véhicules anciens.
Néanmoins, les ZFE font partie des engagements contractuels pris par la France auprès de l’Union européenne pour bénéficier des subventions du PNRR, appelés “jalons” et “objectifs”.
Ces aides, destinées à financer la transition écologique et énergétique, sont conditionnées au respect d’éléments précis, notamment la mise en place de politiques favorisant les mobilités durables et l’amélioration de la qualité de l’air.
En supprimant les ZFE, la France remettrait en cause ces engagements. La Commission européenne pourrait alors considérer cette décision comme une violation des accords contractuels, entraînant un gel des versements futurs et une possible demande de remboursement des fonds déjà perçus.
Ainsi, la note du Trésor est claire : les conséquences financières pourraient dépasser les 3 milliards d’euros. En détail :
- Gel des prochaines tranches d’aides : 3,3 milliards d’euros prévus pour 2025 (suite à l’extension des ZFE cette même année) et jusqu’à 6,1 milliards d’euros pour 2026 pourraient être bloqués.
- Remboursement éventuel : La France pourrait devoir restituer jusqu’à 1 milliard d’euros déjà versés dans le cadre du PNRR.
Il est dans l'intérêt des autorités françaises de conserver les dispositions portant sur les ZFE.
Note de la direction générale du Trésor
Ces pertes ne se limiteraient pas à l’aspect financier. Elles pourraient également entacher la crédibilité de la France auprès des institutions européennes, compromettant sa capacité à négocier ou obtenir des financements futurs.
La suppression des ZFE envoie également un message défavorable à Bruxelles. Le ministère de la Transition écologique a alerté sur les risques politiques liés à cette décision, qui pourrait être perçue comme un recul dans les efforts climatiques. Ce signal pourrait fragiliser les relations entre la France et ses partenaires européens dans un contexte où l’unité est essentielle pour atteindre les objectifs environnementaux communs.
Répercussions sur le financement public et privé ainsi que les professionnels de la logistique et du transport
Pour les professionnels, en particulier ceux du secteur de la logistique et du transport, les ZFE ont entraîné une adaptation coûteuse mais nécessaire. Nombre d’entreprises ont investi dans le renouvellement de leurs flottes pour se conformer aux normes Crit’Air.
Par exemple, dans la métropole du Grand Paris, 17 % des véhicules utilitaires légers immatriculés sont classés Crit’Air 3 ou plus, représentant environ 50 000 véhicules qui nécessitent un remplacement progressif.
Pour rappel, la France pourrait perdre jusqu’à 3 milliards d’euros d’aides européennes prévues pour financer la transition écologique. Cette perte affecterait directement les collectivités locales et les infrastructures publiques, mais également les entreprises dépendantes de ces financements pour développer des solutions durables.
Mais les répercussions ne s’arrêtent pas là : le signal négatif envoyé aux investisseurs privés pourrait freiner le développement de technologies propres, comme les véhicules électriques ou à hydrogène. Les entreprises innovantes pourraient hésiter à investir dans un marché où les réglementations environnementales deviennent instables.
De surcroît, certains secteurs seraient particulièrement touchés par cette suppression :
- Transport et logistique : Avec 27 % des véhicules classés Crit’Air 3 ou plus dans ce secteur, l’abandon des ZFE pourrait aggraver la dépendance aux technologies polluantes.
- Industries liées aux énergies renouvelables : La suppression pourrait ralentir la demande en solutions écologiques comme les bornes de recharge ou les véhicules électriques.
- Collectivités locales : Privées d’une partie des financements européens, elles pourraient être contraintes de réduire leurs projets d’infrastructures durables.
Conclusion
Alors que la suppression des ZFE divise l’opinion publique et anime les débats parlementaires, une chose est claire : les enjeux vont bien au-delà de la simple régulation de la circulation automobile. Ce choix politique, s’il venait à être confirmé, pourrait coûter plus de 3 milliards d’euros à la France, compromettre sa crédibilité européenne, fragiliser les collectivités locales, et déstabiliser des milliers d’acteurs économiques déjà engagés dans la transition écologique.
Pour les professionnels, notamment dans les secteurs du transport, de la logistique, ou de l’innovation verte, c’est une nouvelle incertitude réglementaire qui pèse sur les investissements, les choix stratégiques et les trajectoires de décarbonation. À une époque où les enjeux climatiques exigent cohérence, visibilité et accompagnement, l’abandon brutal des ZFE apparaît comme un recul à haut risque.
Mais face à cette instabilité, une opportunité demeure : celle de prendre les devants, de s’entourer des bons partenaires et de bâtir une stratégie de mobilité durable qui reste rentable, adaptée à la réglementation, et bénéfique pour l’image de votre entreprise.
Chez Beev, nous comprenons à quel point les changements réglementaires peuvent impacter vos activités. C’est pourquoi nous proposons un accompagnement sur mesure pour faciliter votre passage à la mobilité électrique, en tenant compte de vos besoins métiers, de vos contraintes logistiques, et des opportunités de financement disponibles.
Du lundi au vendredi
9h 12h30 · 14h 19h